Si la perspective de voir des acteurs en collants se battre à grands renforts d’effets spéciaux numériques vous laisse de marbre, une rétrospective tombe à point nommé pour relever votre été cinématographique.
En salles depuis le 9 juillet, douze films de Claude Chabrol mettent en lumière une période charnière de sa filmographie : un âge d’or au cours duquel il a signé certains de ses plus grands films. Si l’œuvre du cinéaste et scénariste – né en 1930 et mort en 2010 – est gargantuesque (58 films tournés entre 1958 et 2009), cette rétrospective rendue possible par Tamasa suite à une décision de justice se focalise notamment sur une courte période (1969-1971) durant laquelle il enchaîne cinq longs-métrages majeurs. Suite à sa rencontre en 1967 avec un jeune producteur, André Génovès, Chabrol bénéficie alors d’une sécurité financière qui a dû faire pâlir de jalousie ses collègues de la Nouvelle vague : il est salarié douze mois sur douze, avec un salaire moyen englobant l’écriture, la préparation, le tournage et la postproduction. Le réalisateur adopte le rythme d’un film tous les neuf mois, faisant appel aux mêmes techniciens, et à des acteurs que l’on a plaisir de retrouver dans des rôles très différents.

Dans La Femme infidèle (1969), Stéphane Audran est mariée à Michel Bouquet, qu’elle trompe avec Maurice Ronet. Lorsque le mari découvre l’adultère, cela entraîne des conséquences imprévues, et forcément dramatiques. Faussement réaliste, Chabrol fige, dans une narration en apparence simple, des instants d’hyperréalisme où le réel se fissure, ouvrant la voie à un état de rêverie ou de cauchemar éveillé. Qui est le narrateur du récit ? S’agit-il d’une projection mentale de l’un des personnages ? Ce n’est pas le dernier plan, admirable et sibyllin, qui viendra nous apporter des réponses.

C’est mon Chabrol préféré. Que la bête meure (1969), adapté d’un roman de Cecil Day-Lewis (oui, le père de Daniel !), raconte l’histoire d’un enfant renversé par un chauffard qui prend la fuite sans lui porter secours. Le père de l’enfant décédé (Michel Duchaussoy) va consacrer sa vie à retrouver le meurtrier (Jean Yanne) pour le tuer. Les choses ne se passeront pas exactement comme prévu.
Porté par la musique atonale de Pierre Jansen, le récit est scandé en voix off par le carnet intime que rédige le père endeuillé pour chroniquer sa quête désespérée. Rarement aura-t-on vu des acteurs aussi justes, une direction aussi précise et implacable… Que la bête meure, par son aspect littéraire et tragique, est un grand film, dont chaque vision n’épuise pas les ramifications. Car il nous confronte, nous spectateurs, à un dilemme moral : cet homme qui a souffert a-t-il le droit de faire souffrir à son tour ? Suis-je complice de son acte ?
Dans un entretien en compagnie de Jean Douchet à La Cinémathèque en 1986, le cinéaste, interrogé par Noël Simsolo sur le schéma habituel du film policier, déclare : « J’aime quand le spectateur est impliqué dans l’histoire et qu’il a des choix à faire par rapport à l’histoire. J’ai fait tout un film là-dessus, c’était Que la bête meure, dans lequel on s’identifiait avec un personnage sympathique victime d’un drame. (…) Mais qui devait lui-même commettre un meurtre. (…) Il y a un peu de manipulation du spectateur. On adore s’identifier au départ mais on ne veut pas voir les implications possibles. C’est ça qui est amusant : quand le cinéma cesse d’être complètement un divertissement et qu’on finit par avoir quelque chose sur le dos. »

Tourné dans la foulée et sorti en 1970, Le Boucher réunit deux des acteurs du film précédent : Stéphane Audran et Jean Yanne. Le film nous plonge dans une petite ville du Périgord (Trémolat), où une institutrice se rapproche d’un boucher solitaire. Au fil de leurs rencontres, on apprend à les connaître. Il tombe amoureux, elle repousse doucement ses avances. Mais une série de crimes vient endeuiller la région, et la maîtresse d’école commence à soupçonner le boucher lorsqu’elle découvre un objet compromettant sur une scène de crime. Sur un scénario qu’il signe lui-même (comme de coutume), Chabrol nous place à nouveau au cœur d’un paradoxe : il explore la frontière trouble entre la pitié et le sentiment amoureux.

La Rupture (1970) fait partie des Chabrol les moins connus. Il réunit le duo de La Femme infidèle, Stéphane Audran et Michel Bouquet, dans le récit d’un couple qui se sépare après une crise de démence du mari, Charles (Jean-Claude Drouot), durant laquelle il blesse l’enfant qu’il a eu avec Hélène (Stéphane Audran). Le père de Charles (Michel Bouquet) engage alors une véritable guerre souterraine pour récupérer la garde de l’enfant, n’hésitant devant aucune bassesse. Dans ce film, Chabrol expose comment le sexe, la drogue et l’alcool servent de palliatifs à la médiocrité, et comment la toute-puissance de l’argent permet d’acheter à la fois les consciences et les êtres. Parfois aux frontières du grotesque, La Rupture tire sa force de la truculence de ses seconds rôles, et surtout de l’excellence de Stéphane Audran – devenue madame Chabrol en 1964 – dans le rôle d’une femme en quête d’émancipation, bien décidée à s’extraire du carcan patriarcal pour se suffire à elle-même.

Dernier film de notre sélection, Juste avant la nuit (1971) explore le poids intolérable de la culpabilité. Michel Bouquet y incarne Charles, un bourgeois rangé qui entretient une liaison sadomasochiste avec la femme de son meilleur ami. Quand le jeu pervers tourne mal, l’irréparable est commis et Charles, comme le spectateur, doit désormais affronter l’après. Il finit par se confier à sa femme (Stéphane Audran), dont je vous laisse découvrir la réaction, aussi déroutante que glaçante. Portée, une fois encore, par la musique oppressante de Pierre Jansen, cette étude psychologique à la Dostoïevski nous donne à voir un anti-héros hanté par la faute, incapable de supporter l’idée de rester impuni. Car dans son milieu, la vérité est inacceptable dès lors qu’elle menace l’ordre établi.
Au-delà de la critique de la bourgeoisie, souvent associée à son œuvre, ce qui intéresse surtout Chabrol, ce sont les impasses de leur prétendue morale : « Tout le monde se retrouve face aux contradictions causées par les rapports entre ce que nous pensons être le bien et ce qu’on nous a expliqué que le bien était, et c’est intéressant de voir les moments où ça coince », dit-il.
Un film admirable, qui vient provisoirement clore cette période dorée – laquelle pourra être prolongée par d’autres œuvres, situées en amont comme en aval, grâce à cette rétrospective.
Notre part monstrueuse
Au fond, Chabrol est un cinéaste pour qui l’écran de cinéma fonctionne comme un miroir : un miroir tendu à chacun de nous pour mieux nous scruter. Il nous pousse à affronter notre part monstrueuse… et à l’embrasser.
La femme est au centre de cette période fascinante, souvent désignée comme le cycle « pompidolien », et incarnée sous le même prénom – Hélène – par Stéphane Audran. Ce prénom renvoie à une idée de beauté tragique et classique, évidemment associée à Hélène de Troie, symbole de désir, de fatalité et de trouble. Les personnages interprétés par Audran sont presque toujours ambigus : séduisants, fragiles, manipulateurs ou prisonniers d’un cadre bourgeois oppressant. Le prénom fonctionne à la fois comme repère thématique et comme masque fictionnel, une manière d’unifier des figures féminines proches sans jamais les réduire à une seule. Audran y joue des femmes similaires mais jamais identiques, comme autant de variations sur un même motif. Au fil des films, elle incarne la femme chabrolienne par excellence : élégante, opaque, ambivalente. Une femme moderne, qui n’est plus le simple faire-valoir de l’homme, mais une figure à part entière – désirante, résistante, troublante.
Les films sont projetés notamment au Champo.
Pour aller plus loin, écoutez cette excellente série d’émissions avec notamment Hélène Frappat : Claude Chabrol dissèque le réel sur France Culture.
Ne ratez pas également, si vous êtes en région parisienne, le ciné-club dédié au cinéaste animé par Fabienne Duszynski qui commence le 7 septembre chaque dimanche matin au Louxor.
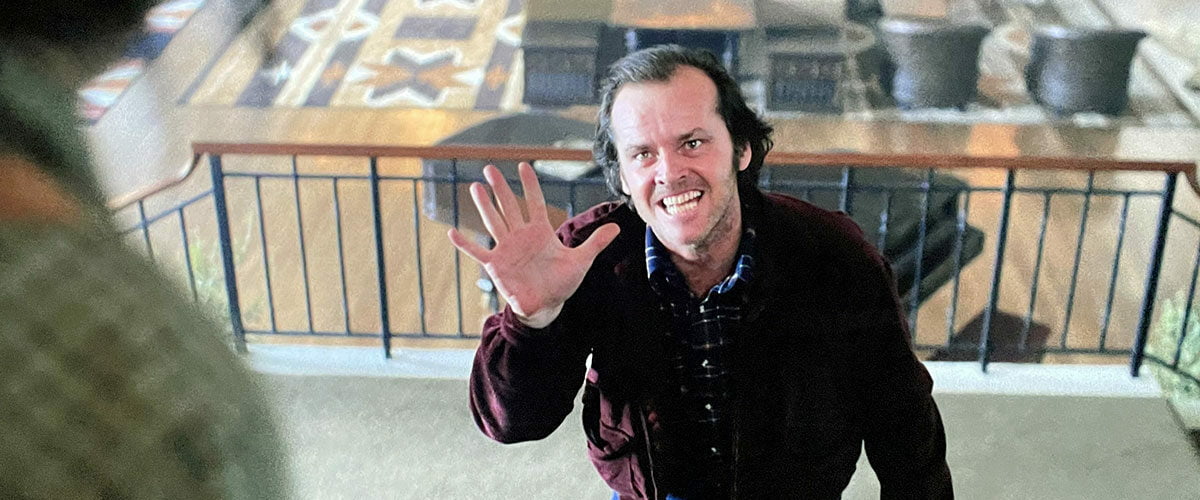

On a de la chance de pouvoir visionner la plupart de ces films dans des conditions optimales, 14 films de Chabrol étant restés bloqués pour des raisons de droits jusqu’à l’année dernière. Toute restauration avait été rendue impossible et certains films n’étaient visibles que dans de piètres copies DVD.
https://www.telerama.fr/cinema/pourquoi-certains-vieux-films-restent-ils-invisibles-6669131.php