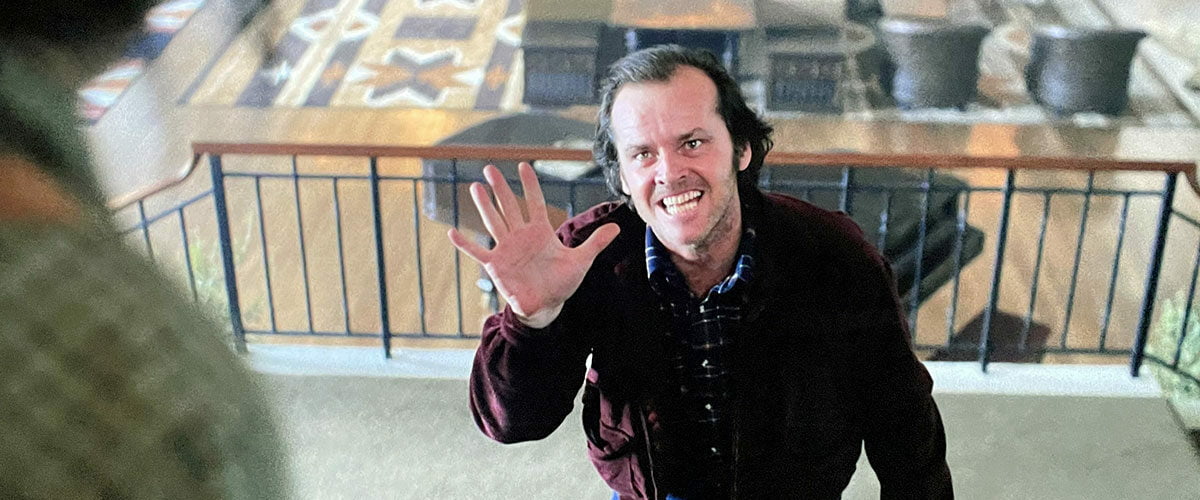Loin d’être un simple outil narratif, le flashback peut aussi semer le doute, transformer la réalité ou créer une légende. C’est ce que nous expose Édouard de Teyssière* dans cet essai inédit et passionnant que je publie avec grand plaisir sur Lightofmylife. Il s’appuie pour sa démonstration sur deux grands films à voir ou revoir de toute urgence : Le Démon des femmes de Robert Aldrich avec Kim Novak et Peter Finch, et Soudain l’été dernier, de Joseph L. Mankiewicz d’après la pièce de Tennessee Williams, avec Elizabeth Taylor et Montgomery Clift. Bonne lecture !
« Le cinéma, art du temps et de la mémoire, trouve dans le motif du flashback un outil privilégié pour explorer les méandres du passé, les zones d’ombre de l’identité et les mécanismes de la légende. Le Démon des femmes (The Legend of Lylah Clare de Robert Aldrich, 1968) et Soudain l’été dernier (Suddenly Last Summer de Joseph L. Mankiewicz, 1959) illustrent à merveille la puissance de ce procédé narratif. Dans ces deux films, la figure centrale – Lylah Clare ou Sebastian Venable – est absente, déjà morte lorsque s’ouvre le récit. Pourtant, leur présence spectrale irrigue chaque plan, chaque dialogue, chaque souvenir. Les flashbacks, loin de simplement reconstituer les faits, deviennent alors des miroirs déformants où se révèlent incertitude, subjectivité et projection. Ils interrogent la nature même du souvenir et du récit, et transforment la quête de vérité en une errance labyrinthique, où réalité et invention se confondent.
L’absence comme moteur narratif et dramatique
Dans Le Démon des femmes, la star éponyme n’apparaît jamais à l’écran : elle est déjà morte, et c’est Elsa Brickmann, jeune femme à la troublante ressemblance, qui est choisie pour l’incarner dans un biopic. Au fil du tournage, Elsa se laisse envahir, puis submerger, par la personnalité de Lylah, jusqu’à se dissoudre dans cette identité fantasmée. L’intrigue met ainsi en scène la contamination du présent par un passé inaccessible, la porosité des frontières entre soi et l’autre, entre réalité et fiction. De façon parallèle, Soudain l’été dernier s’ouvre sur l’absence de Sebastian, mort dans des circonstances mystérieuses l’été précédent. Le film suit sa mère, Mrs. Venable, et sa cousine Catherine, seule témoin du drame. Sebastian n’existe plus que dans les récits, les souvenirs, les allusions. Il devient une figure de l’ombre, un objet de fascination et de terreur, dont la vérité ne peut émerger qu’à travers la parole des autres. Dans les deux cas, l’absence physique du personnage central n’est pas un manque, mais un moteur dramatique. Elle crée un vide autour duquel s’organise la narration, un espace que les autres personnages – et le spectateur – s’efforcent de combler par l’imaginaire, la mémoire, le fantasme. Ce vide devient le lieu de toutes les projections et de toutes les interprétations.

Les flashbacks : entre reconstitution, mythe et subjectivité
Les flashbacks, dans ces films, ne sont pas de simples retours en arrière destinés à livrer des informations objectives sur le passé. Ils sont au contraire profondément subjectifs, fragmentés, ambigus, et révèlent la difficulté, voire l’impossibilité, d’accéder à une vérité unique. Dans Le Démon des femmes, trois flashbacks stylisés présentent autant de versions contradictoires de la mort de la star : accident, crime passionnel, ou assassinat prémédité. Chacun de ces retours en arrière est coloré par le point de vue, les désirs ou les manipulations du personnage qui le raconte. Les scènes, filmées en noir et blanc avec des encadrements rouges, brouillent la frontière entre souvenir et invention, entre réalité et fiction. Elles révèlent moins la vérité sur Lylah que les obsessions, les traumatismes et les stratégies de ceux qui l’entouraient. Lylah devient alors un mythe, une figure insaisissable, façonnée par les récits croisés et contradictoires de son entourage. Dans Soudain l’été dernier, les flashbacks sont le cœur même du récit. Sous l’effet d’un « sérum de vérité », Catherine livre peu à peu des souvenirs morcelés, hallucinés, de la mort de Sebastian. Le montage, volontairement fragmenté, les surimpressions d’images, les faux raccords, plongent le spectateur dans un état d’incertitude permanente. La mémoire de Catherine est instable, contaminée par le traumatisme, la culpabilité, la peur. Sebastian, absent du champ, devient une figure spectrale, une construction, symbole des non-dits et des tabous. Sa mort, brutale et métaphorique – on ne la révèlera pas ici – condense les thèmes de la prédation, de la transgression, de la punition sociale. Mais ce récit, halluciné, ne livre jamais une vérité définitive : il reste marqué par l’ambiguïté, le doute, la projection.

L’ambiguïté du passé : incertitude, interprétation, projection
Ce qui frappe dans ces deux films, c’est la manière dont les flashbacks fonctionnent comme des reflets de la vie elle-même : incertitude, interprétation, projection. Le passé, loin d’être un territoire stable et accessible, apparaît comme un champ mouvant, traversé de contradictions, de refoulements, de fantasmes. Dans Le Démon des femmes, chaque version de la mort de Lylah en dit plus sur celui ou celle qui la raconte que sur la star elle-même. Les flashbacks révèlent les désirs inavoués, les traumatismes, les stratégies de pouvoir des personnages. Lylah n’est plus une personne, mais un écran de projection, une surface sur laquelle se dessinent les obsessions collectives : beauté, pouvoir, désir, scandale. Le film met ainsi en scène la fabrication du mythe hollywoodien, la réduction de l’individu à une image publique, à une légende façonnée par les autres. Dans Soudain l’été dernier, la mémoire de Catherine est le théâtre d’une lutte intérieure. Les souvenirs, fragmentés, altérés par le choc, se mêlent à la peur, à la honte, à l’angoisse. Le récit de la mort de Sebastian devient une sorte de cauchemar éveillé, où passé et présent se confondent, où la vérité se dérobe sans cesse. Sebastian, invisible, incarne tout ce qui ne peut être dit, tout ce qui doit rester caché : sexualité, violence, marginalité. Il est à la fois victime et bourreau, fantasme et tabou.

La construction du mythe : figures spectrales et fantasmes collectifs
L’absence de Lylah et de Sebastian, loin de les effacer, les élève au rang de figures mythiques. Ils deviennent des symboles, des archétypes, des objets de fascination collective. Leur humanité s’efface au profit de leur statut d’icônes, de légendes, de projections des désirs et des peurs de leur entourage. Dans Le Démon des femmes, la star disparue se recompose à travers les récits, les souvenirs, les fantasmes de ceux qui l’ont connue. Mais chaque version est biaisée, partielle, intéressée. Lylah devient une chimère, une construction collective, un mythe hollywoodien. Elsa, qui tente de l’incarner, finit par se perdre elle-même, absorbée par cette identité fantasmée, démontrant la puissance destructrice du mythe. Dans Soudain l’été dernier, Sebastian, invisible, incarne tout ce qui dérange, tout ce qui doit être tu. Sa mort atroce, racontée comme une hallucination, fait de lui le symbole des tabous et des non-dits. Il est à la fois le centre du récit et un pur produit de la mémoire traumatique de Catherine, de la volonté de contrôle de sa mère, et du regard de la société.
Le flashback comme reflet de l’incertitude existentielle
Au-delà de leur fonction narrative, les flashbacks de ces deux films deviennent de véritables reflets de la condition humaine : tout y est incertitude, interprétation, projection. Ils mettent en scène la difficulté de saisir la vérité, la fragilité de la mémoire, la puissance des fantasmes. Le passé, loin d’être un socle, est un terrain mouvant, un labyrinthe où chaque récit ouvre sur de nouvelles énigmes. Ces retours en arrière, souvent stylisés, parfois surréalistes, donnent aux films une dimension onirique, troublante, où la frontière entre rêve et réalité, entre souvenir et invention, est sans cesse brouillée. Ils invitent le spectateur à s’interroger sur la nature du récit, sur la fabrication du mythe, sur la fragilité de l’identité.
Conclusion
Le Démon des femmes et Soudain l’été dernier s’inscrivent par ailleurs dans une tradition plus vaste du cinéma du flashback. Il est pertinent de rappeler que ce procédé ne se limite pas à ces deux œuvres, mais irrigue de nombreux films qui interrogent la mémoire, la subjectivité et la construction du mythe. Parmi eux, La Comtesse aux pieds nus de Joseph L. Mankiewicz (1954) s’impose comme un exemple majeur. Le film retrace la vie de Maria Vargas à travers une succession de récits croisés et de flashbacks, chacun porteur du regard, des désirs et des illusions de celui qui raconte. Ce procédé se retrouve aussi dans Ève (All About Eve) de Mankiewicz (1950), où le destin d’Eve Harrington est reconstitué à travers les souvenirs subjectifs de plusieurs protagonistes, ou encore dans des films plus contemporains comme Memento de Christopher Nolan (2000), où la structure même du récit, entièrement en flashbacks inversés, place le spectateur dans un état d’incertitude permanente quant à la réalité des faits. À chaque fois, il s’agit moins de reconstituer une vérité que de montrer la complexité du souvenir, la fragilité de la mémoire, et la manière dont le passé se construit à travers le prisme de l’interprétation. Dans ces films, le flashback devient un outil dramaturgique et psychanalytique : il ne révèle pas seulement le passé, il met en scène l’incertitude, la projection et la fabrique du mythe. À travers ces récits fragmentés, le cinéma nous rappelle que la vérité n’est jamais donnée, mais toujours à reconstruire, entre mémoire, fantasme et invention. »
* J’avais rédigé avec Édouard de Teyssière en 2022 un article intitulé « A la recherche des films invisibles » à lire sur Le Bleu du miroir.