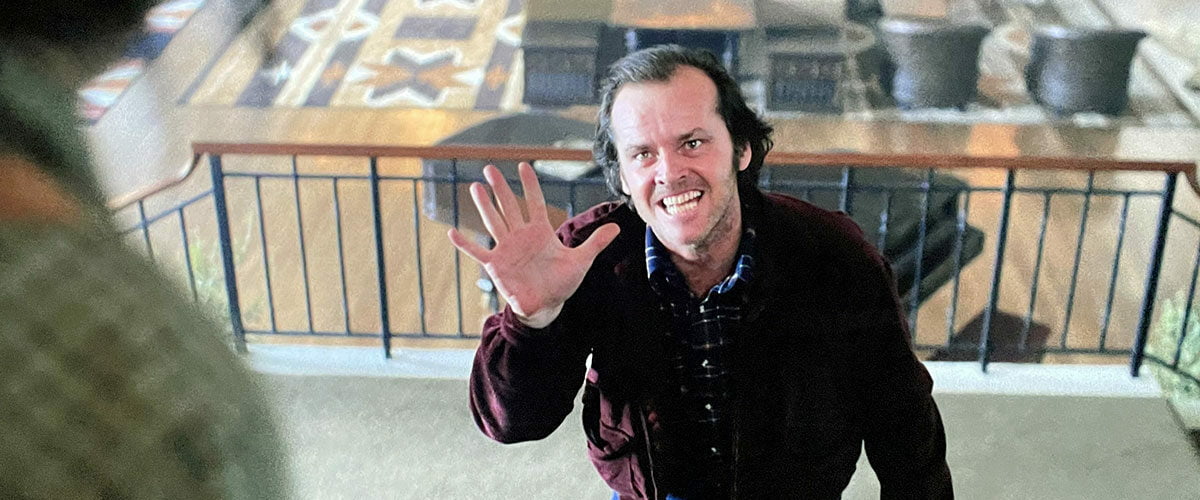A quoi ressemblerait le monde après l’effondrement de la civilisation ? C’est à cette angoissante question que répondait le livre de Cormac McCarthy paru en 2006, qui a connu un large succès (800 000 exemplaires vendus en France) et a reçu le prix Pulitzer. Nul doute que cette histoire d’errance d’un homme et son jeune fils dans un monde post-apocalyptique a touché une corde sensible dans la psyché collective. Au point d’inspirer un film homonyme en 2009 (réalisé par John Hillcoat avec Viggo Mortensen) et un jeu vidéo en 2013 (The Last of Us).
Dans un monde où le mot société n’a plus de sens, chacun lutte pour sa survie. De cette trame narrative simple, l’auteur de bandes dessinées Manu Larcenet a tiré une adaptation parue fin mars, qui fait depuis partie des meilleurs ventes d’albums. L’auteur, né en 1969, resserre l’intrigue sur le roman, quand le film l’élargissait au contraire en y ajoutant des flash-back sur la mère du petit garçon.
On retrouve ici la sècheresse implacable du roman, mise en relief par des dessins admirables, l’utilisation parcimonieuse des couleurs, un sens de l’ellipse consommé, pour un récit angoissant où le silence pèse aussi lourd que les nuages de cendres. Parcourant des villes détruites, des champs stériles, des forêts mortes, l’homme et son fils sont en constante recherche de nourriture, et vivent dans la peur des mauvaises rencontres. Les animaux ont disparu. La mort et la désolation sont omniprésentes, et de ces multiples visions d’horreur, Manu Larcenet parvient à dégager des moments d’une étrange beauté. Comme cette scène où le garçon baigne son corps décharné dans l’océan, bref moment de joie que le dessin traduit avec une admirable retenue.
J’abordais dans un précédent post la destruction nucléaire telle qu’imaginée dans les années 1980 par des auteurs qui cherchaient à tirer la sonnette d’alarme pour éviter le pire. Depuis, la peur de l’apocalypse ne s’est pas tarie, et la situation géopolitique actuelle y est pour beaucoup. Dans ce monde en perpétuelle instabilité, pourquoi prenons-nous plaisir à imaginer le pire ? Pourquoi sommes-nous si fascinés par les images de fin du monde ? Est-ce pour mettre des mots sur nos angoisses profondes ? Est-ce un plaisir morbide ? Ou une catharsis nécessaire ? Un peu tout cela. C’est surtout en période de crise que les films catastrophe marchent le mieux, comme on a pu le voir dans les années 1970, ou lors de la pandémie qui a remis au goût du jour le film de Steven Soderbergh Contagion, un phénomène sur lequel se sont penchés les chercheurs. Ces fictions nous aideraient à appréhender la réalité pour mieux la vivre et à penser ce qui est du domaine de l’impensable. Le sujet a été étudié par la philosophe Cynthia Fleury, qui parle de la catastrophe comme une esthétique particulièrement prisée par nos sociétés soumises à un flux ininterrompu d’images. La chercheuse américaine Angela Becerra Vidergar (Université de Stanford), quant à elle, estime que le lecteur ou le spectateur manifeste au travers de son goût pour ces fictions son désir de survie, mais aussi sa volonté d’améliorer le monde, d’œuvrer comme ses héros à la construction d’un monde meilleur.
Malgré son extrême noirceur, rappelons-nous que le livre de McCarthy (qui nous a quittés le 13 juin 2023) se terminait sur une note d’espoir. Si le pire ne peut être évité, si la race humaine est incapable de contrôler ses pulsions auto-destructrices, il sera toujours temps de recommencer à zéro.